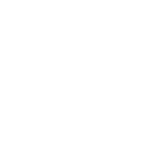PARADOXAL !
Encore une fois je suis ressorti bouleversé du spectacle annuel de la Fabrique Opéra Val de Loire. J’écris ces lignes vers 5h30 du matin, c’est à dire 6 ou 7h seulement après la fin de la représentation, et je n’arrive toujours pas à comprendre comment ils ont fait.
Ce spectacle est miraculeux. Il reste quelques places pour ce soir, si jamais vous n’aviez pas encore pris les vôtres, foncez ! (c’est ici)
Alors, moi, Nabucco, comment dire… j’avais un a priori. J’imaginais une sorte d’énorme péplum servant de piste d’envol pour ténors et sopranes en mal de contre-ut. Ça partait mal…
J’avais tellement peur d’être déçu que j’ai joué à fond le jeu du spectateur lambda. C’est à dire que je n’ai rien lu sur le livret, rien écouté de plus que le célèbre Va, pensiero. Je ne connaissais rien de l’histoire, et je craignais un Verdi un peu… pompeux (un peu tonique/dominante, si vous préférez).
Mais puisque n’importe quel membre de la Fabrique Opéra vous dira que la production s’adresse à tous, que tout le monde peut y trouver son compte, qu’on soit connaisseur ou non, que même si on a peur parce que c’est chanté en italien on comprendra parce que les dialogues seront en français, etc.
Soit ! Je joue le jeu et j’y vais confiant, parce que c’est La Fabrique Opéra Val de Loire, et que c’est Clément qui dirige et que, vous le savez, même lorsqu’on reste objectif comme moi, on sait que mon frère est un génie (ça parait une blague à force, mais d’une part je le pense vraiment, et en plus, objectivement, c’est vrai) . Je m’attends donc à ce que ce soit super, malgré mes craintes.
En arrivant, je lis tout de même le synopsis qui est dans le programme. Sincèrement, je ne voulais pas le lire mais au dernier moment, j’ai craqué.
Bon. Ça ne m’a pas rassuré du tout.
Mais l’orchestre est entré en scène. Puis Clément
Vous n’imaginez pas ce que je ressens lorsque Clément entre en scène au Zénith. C’est un drôle de mélange entre trac et confiance totale ; fierté – comme si j’y étais pour quelque chose… – et admiration ; ainsi qu’un désir complètement contradictoire : que ce moment musical dure une éternité parce que je le vois, je le sens vivant et à sa place et qu’il se termine rapidement pour lui dire à quel point ce qu’il nous offre est éblouissant. Bref, une sensation très étrange et paradoxale sur plusieurs points.
Le spectacle commence… et je décolle immédiatement. Tout le monde décolle car l’orchestre est impeccable. Dès les premières notes le public sait qu’il a la chance d’écouter un ensemble d’exception. « Tu en doutais ? » me diriez-vous…
Non, car ce n’est pas la première fois que j’entends l’orchestre Inattendu, mais Verdi écrit de tels pièges pour les instrumentistes ! Pas uniquement parce qu’il écrit parfois des choses techniquement difficiles à réaliser seul mais il impose une telle rigueur par son orchestration: des unissons dans le pupitres des bois qui n’admettraient aucune approximation ; des accords de cuivres qui pourraient être mal équilibrés ; des petites volutes aux cordes qui pourraient faire Scroutch mouniou-mouniou (pas facile de transcrire un petit motif mélodique mal joué au violon. Mais Scroutch mouniou-mouniou m’a paru assez explicite).
Là, on sent que tout le monde dans l’orchestre est soudé, unis dans un désir de spectacle total. Il n’y a pas eu une note chantée encore, mais on sent que ce n’est pas de la musique de concert, c’est une ouverture d’opéra. Une sorte de teaser pour mettre en appétit. Et au bout de 30 seconde à peine, de l’appétit, on en a !
Pendant ce temps, on découvre sur le côté les premiers effets de mise en scène, les premières ombres ombres, et c’est suffisamment lent, long et beau pour qu’on comprenne le procédé, qu’on l’accepte, un peu comme quand on intègre les règles d’un nouveau jeu. Je ne vais pas dévoiler ce qui va nous accompagner tout au long de la pièce mais ces jeux de lumières et la mise en scène de Cécile Hurbault nous permettent de nous éloigner totalement de ce que je craignais : un gros péplum plein de crème et d’effets trop lourds. C’est magnifique. La scénographie de Ludovic Meunier, comme toujours incroyablement efficace, accompagne la mise en scène avec une facilité déconcertante. Même chose pour les costumes de Paula Dartigues ! D’abord, ils sont magnifiques, ça on commence à en avoir l’habitude, mais en plus ils semblent tellement simples, tellement naturels !
Ce que j’aime particulièrement pour la scénographie ou les costumes c’est qu’on pourrait penser qu’il n’y a peut-être pas eu besoin d’y réfléchir tant que ça tellement tout semble tomber sous le sens.
On sait bien que pour proposer l’évidence il faut être passé par des chemins parfois sinueux et difficiles, le lendemain on réalise peut-être qu’il y a dû en avoir des heures de travail avec les costumier(e)s, les lycéens-scénographes, des jours (des semaines ?) de réflexion, mais sur le moment, dans le public, nous n’y pensons pas. On profite. On s’émerveille.
Quand au concours de « à celui qui chantera le plus haut ou le plus fort » que j’appréhendais : il aura suffit du deuxième contre-ut de Marilyn Clément (qui joue Abigaïlle) pour que mon inquiétude s’éloigne. Quelle légèreté, quelle finesse ! Tous les solistes d’ailleurs se mettent au service du spectacle sans essayer de tirer la couverture. Les moments en trio ou en quatuor sont formidables parce qu’on sent qu’ils s’écoutent. Amusez-vous à écouter ces moments-là dans les versions dites « de référence » (je suis en train de le faire en écrivant mon texte). On est parfois bien loin du son de l’ensemble vocal !
Mais bien sûr, comme le répète Clément depuis qu’il a commencé son périple régional avec ses causeries & conférences… – car si le Zénith est quasi complet sur les trois dates (il reste quelques places ce soir) c’est que le chef d’orchestre et toute l’équipe de la production sont venus chercher chacun de nous avec les dents pour nous tirer de notre torpeur et nous amener dans la salle en nous proposant bon nombre de manifestations festives et pédagogiques – or, comme il aime à le répéter, le personnage principal, c’est le chœur !
Quelle fierté pour moi d’avoir été le premier orléanais à découvrir la cheffe de chœur Corinne Barrère !
Impériale Corinne.
Depuis quelques années certains sympathisants, vantant le travail de La musique de Léonie et particulièrement celui de Corinne, disent pour convaincre de travailler avec nous, qu’elle « saurait faire chanter une porte ». Des « portes », comme ils disent, il n’y en a pas dans le chœur-opéra. Bien sûr. Mais qui parmi les choristes aurait pu imaginer il y a encore un an être capable de faire ce qu’il/elle a fait hier soir ? Chanter autant de morceaux pas toujours (et même jamais) faciles tout en jouant la comédie sans quasiment jamais quitter la scène ? Et cela avec une aisance et un naturel désarmant.
Je n’ai pas pu vous croiser tous à la sortie, mais vous m’avez subjugué. Au point qu’à la fin de chaque scène, je lançais un « oh ! » admiratif, faisant se retourner mon voisin de devant (pardon Monsieur si vous me lisez. Les premiers « oh! », j’ai vu, vous avez sursauté un peu, je le comprends). Là encore, c’est comme avec l’entrée de Clément, c’est un très paradoxal ce que j’ai ressenti en écoutant le chœur : c’était à la fois géant, grandiose et en même temps très subtil et très intime.
En écrivant ces derniers mots, je m’aperçois qu’ils résument mon sentiment pour ce spectacle (j’aurais pu éviter d’écrire cette tartine, ça vous aurait fait gagner du temps) : c’était grandiose… et intime.
Moi qui m’attendais, enfermé dans mon a priori, à revivre en un peu moins monumental de ce que j’avais vécu adolescent en découvrant Ben Hur, je me suis retrouvé dans un souvenir encore plus ancien : le théâtre de marionnettes où m’emmenait alors que je devais avoir 4 ans, ma grand-mère. Le théâtre devait certainement être tout petit (peut-être 30 places), ça me paraissait immense. Les histoires devaient être simplissimes, elles me paraissaient incroyables et nourrissaient mon imaginaire pour des semaines. Jamais je n’oublierai la musique d’ouverture, qui me paraissait la marche la plus triomphale qu’on puisse imaginer.
Hier, vous (je m’adresse là à chacun des acteurs de cette production, artistes, techniciens, bénévoles, administrateurs…), vous avez pris un opéra GIGANTESQUE avec un livret dont j’avoue ne pas avoir forcément envie d’étudier à l’avenir les ressorts dramatiques, une musique parfois un peu trop – je ne sais pas comment qualifier, c’est difficile d’émettre une réserve sur la musique d’un géant – disons un peu trop tonique/dominante, même si on peut y trouver des moments absolument géniaux :
- le solo de violoncelle, (mille bravos à Anne-Laure Py – c’est ridicule je sais de ne citer qu’un nom de musicienne, tous et toutes ont été formidables, mais ça me faisait plaisir de lancer « Bravo Anne-Laure Py », et bim ! deux fois) suivi d’un sextuor de violoncelles, si j’ai bien compté qui en plus, alors qu’on croit qu’il ne s’agissait que d’une introduction, accompagne la scène entière d’Ismaële, magique ! ;
- le Va pensiero bien sûr ;
- et aussi la fin, avec cette association (j’espère ne pas me tromper) cor anglais, harpe, violoncelle solo et contrebasse. Orchestration absolument ahurissante, on aurait dit une musique de Nino Rota en encore plus géniale (pardon aux fans de Nino Rota, mais Verdi gagne sur ce passage-là) ;
- et encore les moments avec la fanfare de scène qui font aussi penser aux films de Fellini ;
- sans parler bien évidemment de sa maîtrise totale de l’art vocal qui permet aux interprètes de nous faire vibrer au delà de ce qu’on imaginait…
Vous aviez donc un opéra gigantesque et vous avez réussi à me faire vivre (à nous faire vivre ?) un spectacle intime, délicat, subtil…
Le résultat, encore une fois, était GÉANT.
Si ce n’est pas paradoxal, ça…
J’ai fini mon texte, j’arrête d’écouter Nabucco, je vais maintenant mettre La marche des gladiateurs de Julius Fucik. Ça m’émeut, j’ai l’impression que ma grand-mère me tient la main.
Merci la Fabrique Opéra, tous mes vœux de succès pour ce soir et demain.
(Merci à Clodelle Claudine pour la photo que je lui ai volée sur Facebook. J’espère ne pas avoir fait de bêtise…)