Pasteis de nata et Pessoa
J’ai passé 3 jours à Lisbonne. C’était formidable. D’abord parce que c’était une surprise à l’occasion de mon anniversaire, et aussi parce que c’est une ville magnifique. Les gens que nous avons croisés étaient gentils, accueillants, arrangeants ; tout ce que nous avons fait là-bas, que ce soit une visite d’un monastère, une balade (en prenant le célèbre tramway 28 !), un repas (pique-nique ou resto), tout s’est déroulé avec une facilité déconcertante.

Je serais bien incapable de hiérarchiser les émotions que j’ai pu ressentir durant le séjour car finalement, tout n’était qu’émotion :
Le quartier Alfama, le monastère des Hiéronymites, le point de vue qu’offre château Saint-Georges, le bonheur que peut procurer un seul type avec une guitare faisant danser des dizaines de personnes dans la rue, les façades extraordinaires des maisons, la bacalhau (morue) sous toutes ses formes, la caldo verde (soupe bien nourrissante), les sardines, le polvo à lagareiro (poulpe, j’adore !) et évidemment les pastels de Nata (en trois jours, je ne sais pas exactement combien j’en ai mangés, mais je suis sûr de ne jamais donner d’estimation à mon médecin !)…

J’ai adoré. Ça fait plus d’une semaine que j’en suis revenu, mais je ressens un peu le besoin de garder l’esprit lisboète (pas sûr qu’on puisse utiliser lisboète comme adjectif…). Alors je me suis replongé dans Fernando Pessoa et son immense Livre de l’intranquilité.

Juste comme ça pour le plaisir, quelques morceaux choisis :
Comme tous les êtres doués d’une grande mobilité mentale, j’éprouve un amour organique et fatal pour la fixité. Je déteste les nouvelles habitudes et les endroits inconnus.
Ou encore :
27 juillet 1930
La plupart des gens souffrent de cette infirmité de ne pas savoir dire ce qu’ils voient ou ce qu’ils pensent. On dit que rien n’est plus difficile que de définir par des mots une spirale ; on prétend qu’il faut dessiner en l’air, de la main et sans littérature, le mouvement ascendant et sagement enroulé par lequel cette figure abstraite des ressorts et de certains escaliers se manifeste à nos yeux. Mais si l’on se souvient que dire, c’est renouveler, on définira une spirale sans difficulté : c’est un cercle qui monte sans jamais se refermer. La plupart des gens, je le sais bien, n’oseraient jamais une telle définition abstraite. J’aurai recours au concept, et l’on verra aussitôt ce que je veux dire : une spirale, c’est un serpent sans serpent, qui s’enroule verticalement autour de rien.
La littérature toute entière est un effort pour rendre la vie bien réelle. Comme nous le savons tous, même quand nous agissons sans le savoir, la vie est absolument irréelle dans sa réalité directe : les champs, les villes, les idées, sont des choses totalement fictives, nées de notre sensation complexe de nous-mêmes. Toute nos impressions sont incommunicables, sauf si nous en faisons de la littérature. Les enfants sont de grands littérateurs, car ils parlent comme ils sentent, et non pas comme on doit sentir lorsque l’on sent d’après quelqu’un d’autre… J’ai entendu un enfant dire un jour, pour suggérer qu’il était sur le point de pleurer, non pas : “J’ai envie de pleurer”, comme l’eût dit un adulte, c’est-à-dire un imbécile, mais : “J’ai envie de larmes.” Et cette phrase, totalement littéraire, au point qu’on la trouverait affectée chez un poète célèbre (s’il s’en trouvait un pour l’écrire), se rapporte directement à la chaude présence des larmes jaillissant sous les paupières, conscientes de cette amertume liquide. “J’ai envie de larmes” ! Cet enfant, tout jeune encore, avait fort bien défini sa spirale.’
Dire ! Savoir dire ! Savoir exister par la voix écrite et l’image mentale ! La vie ne vaut pas davantage : le reste, ce sont des hommes et des femmes, des amours supposées et des vérités factices, subterfuges de la digestion et de l’oubli, êtres s’agitant en tous sens – comme ces bestioles sous une pierre qu’on soulève – sous le vaste rocher abstrait du ciel bleu et dépourvu de sens.
Bigre ! Ça résonne tellement en moi. Allez, encore un peu :
L’intensité des sensations a toujours été plus faible, chez moi, que l’intensité de la conscience (sensation) que j’en avais. J’ai toujours souffert davantage de ma conscience de la douleur que de la souffrance même dont j’avais conscience.
La vie de mes émotions a choisi de s’installer, dès l’origine, dans les salons de la pensée, et j’ai toujours vécu là plus largement ma connaissance émotive de la vie.
Et comme la pensée, lorsqu’elle héberge l’émotion, devient plus exigeante qu’elle, ce régime de la conscience, où j’ai opté de vivre ce que je ressentais, a rendu ma manière de sentir plus quotidienne, plus titillante et plus épidermique.
Je me suis créé écho et abîme, en pensant. Je me suis multiplié, en m’approfondissant. L’épisode le plus minime – un changement né de la lumière, la chute enroulée d’une feuille, un pétale jauni qui se détache, une voix de l’autre côté du mur, ou les pas de la personne qui parle auprès d’une autre qui probablement l’écoute, le portail entrebâillé sur le vieux jardin, le patio ouvrant ses arcades parmi les maisons se pressant sous la lune – toutes ces choses, qui ne m’appartiennent pas, retiennent ma méditation sensible dans les liens de la résonance et de la nostalgie. Dans chacune de ces sensations je suis autre, je me renouvelle douloureusement dans chaque impression indéfinie.
Je vis d’impressions qui ne m’appartiennent pas, je me dilapide en renoncements, je suis autre dans la manière même dont je suis moi.
Un dernier, un peu long, mais si vous sautez des lignes, lisez malgré tout le dernier paragraphe, ça vous donnera envie de lire ce que vous avez sauté :
Il est une érudition de la connaissance, qui est ce que l’on appelle proprement l’érudition, et une érudition de l’entendement, qui est ce que l’on appelle la culture. Mais il y a aussi une érudition de la sensibilité.
Cette érudition de la sensibilité n’a rien à voir avec l’expérience de la vie. L’expérience de la vie n’enseigne rien, de même que l’histoire ne nous informe en rien. La véritable expérience consiste à restreindre le contact avec la réalité, et à intensifier l’analyse de ce contact. Ainsi la sensibilité vient-elle à se développer et à s’approfondir, car tout est en nous-mêmes ; il nous suffît de le chercher, et de savoir le chercher.
Qu’est-ce que voyager, et à quoi cela sert-il ? Tous les soleils couchants sont des soleils couchants ; nul besoin d’aller les voir à Constantinople. Cette sensation de libération, qui naît des voyages ? Je peux l’éprouver en me rendant de Lisbonne à Benfica, et l’éprouver de manière plus intense qu’en allant de Lisbonne jusqu’en Chine, car si elle n’existe pas en moi-même, cette libération, pour moi, n’existera nulle part. « N’importe quelle route, a dit Carlyle, et même cette route d’Entepfuhl, te conduit au bout du monde. » Mais cette route d’Entepfuhl, si on la suit jusqu’au bout, revient à Entepfuhl ; si bien qu’Entepfuhl, où nous nous trouvions déjà, est aussi ce bout du monde que nous cherchions à atteindre.
Condillac commence ainsi son célèbre ouvrage : « Si haut que nous montions, si bas que nous descendions, nous ne sortons jamais de nos sensations. » Nous ne débarquons jamais de nous-mêmes. Nous ne parvenons jamais à autrui, sauf en nous autruifiant par l’imagination, devenue sensible à nous-mêmes. Les paysages véritables sont ceux que nous créons nous-mêmes car, étant leurs dieux, nous les voyons comme ils sont véritablement, c’est-à-dire tels qu’ils ont été créés. Ce qui m’intéresse et que je puis véritablement voir, ce n’est aucune des Sept Parties du Monde ; c’est la huitième, que je parcours et qui est réellement mienne.
Quand on a sillonné toutes les mers, on n’a fait que sillonner sa propre monotonie. J’ai déjà sillonné plus de mers qu’il n’en existe au monde, j’ai vu plus de montagnes qu’il n’y en a sur terre. J’ai traversé des villes plus que réelles, et les vastes fleuves de nulle part au monde ont coulé, absolus, sous mon regard contemplatif. Si je voyageais, je ne trouverais que la pâle copie de ce que j’ai déjà vu sans jamais voyager.
Dans les contrées qu’ils visitent, les autres se trouvent étrangers, anonymes. Dans celles que j’ai visitées, j’ai été non seulement le plaisir caché du voyageur inconnu, mais la majesté du Roi qui y règne,le peuple qui y pratique ses coutumes, et l’histoire entière de cette nation et de ses voisines. Paysages,maisons, j’ai tout vu parce que j’ai été tout — tout cela créé en Dieu avec la substance même de mon imagination.
Renoncer, c’est nous libérer. Ne rien vouloir, c’est pouvoir.
Que peut me donner la Chine que mon âme ne l’ait déjà donné ? Et si mon âme ne peut me le donner, comment la Chine me le donnera-t-elle, puisque c’est avec mon âme que je verrai la Chine, si je la vois jamais ? Je pourrai m’en aller chercher la richesse en Orient, mais on point la richesse de l’âme, parce que cette richesse-là, c’est moi-même, et que je suis là où je suis, avec ou sans Orient.
Je comprends que l’on voyage si on est incapable de sentir. C’est pourquoi les livres de voyages se révèlent si pauvres en tant que livres d’expérience, car ils ne valent que par l’imagination de ceux qui les écrivent. Si leurs auteurs ont de l’imagination, ils peuvent nous enchanter tout autant par la description minutieuse, photographiqe à l’égal d’étendards, de paysages sortis de leur imagination, que par la description, forcément moins minutieuse, des paysages qu’ils prétendent avoir vus. Nous sommes tous myopes, sauf vers le dedans. Seul le rêve peut voir avec le regard.Au fond, notre expérience terrestre comporte seulement deux choses : l’universel et le particulier. Décrire l’universel, c’est décrire ce qui est commun à toute âme humaine, à toute expérience humaine – le ciel profond, avec le jour et la nuit qui se produisent en lui et à partir de lui ; l’écoulement des fleuves, tous de la même eau fraîche et sororale ; les mers, les montagnes au lointains tremvlants, préservant la
majesté des hauteurs dans le secret des profondeurs ; les saisons, les champs, les maisons, les gestes et les visages ; les costumes et les sourires ; l’amour et les guerres ; les dieux, finis et infinis ; la Nuit sans forme, mère de l’origine du monde ; le Destin, ce monstre intellectuel, qui est tout… En décrivant toutes ces choses, ou quoi que ce soit d’autre tout aussi universel, je parle à l’âme dans la langue primitive et divine, l’idiome adamique que tous les hommes comprennent. Mais quelle langue morcelée, quelle langue babélique parlerais-je si je décrivais l’ascenseur de la Santa Justa, la cathédrale de Reims, la culotte des zouaves ou la façon dont on prononce le portugais dans le Trás-os-Montes ? Autant de choses qui sont des accidents de la surface ; on peut les sentir en marchant, mais non pas en sentant. Ce qu’il y a d’universel dans l’ascenseur de Santa Justa, c’est la mécanique régissant le monde. Ce qu’il y a de vérité dans la cathédrale de Reims, ce n’est ni la cathédrale, ni la ville de Reims, mais la majesté religieuse des éfifices voués à la connaissance des profondeurs de l’âme humaine. Ce qui est éternel dans la culotte des zouaves, c’est la fiction colorée des costumes, langage humain qui crée une simplicité d’ordre social constitutant, à sa façon, une nudité nouvelle. Ce qui, dans les parlers régionaux, est universel, c’est l’intonation familière de gens qui vivent spontanément, la diversité des êtres proches, la succession bigarrée des façon d’être, les différences entre les peuples et la grande diversité des nations.
Éternels passagers de nous-mêmes, il n’est pas d’autre paysage que ce que nous sommes. Nous ne possédons rien, car nous ne nous possédons pas nous-mêmes. Nous n’avons rien parce que nous ne sommes rien. Quelles mains pourrais-je tendre, et vers quel univers ? Car l’univers n’est pas à moi : c’est moi qui suis l’univers.
_____
Mais bien sûr, comme tous les jeudis, nous continuons notre cycle “Un an de chansons” autour des poèmes de Jean-Luc Moreau. Cette semaine, une chanson cruelle : une comptine pour éliminer !
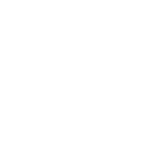
 majesté des hauteurs dans le secret des profondeurs ; les saisons, les champs, les maisons, les gestes et les visages ; les costumes et les sourires ; l’amour et les guerres ; les dieux, finis et infinis ; la Nuit sans forme, mère de l’origine du monde ; le Destin, ce monstre intellectuel, qui est tout… En décrivant toutes ces choses, ou quoi que ce soit d’autre tout aussi universel, je parle à l’âme dans la langue primitive et divine, l’idiome adamique que tous les hommes comprennent. Mais quelle langue morcelée, quelle langue babélique parlerais-je si je décrivais l’ascenseur de la Santa Justa, la cathédrale de Reims, la culotte des zouaves ou la façon dont on prononce le portugais dans le Trás-os-Montes ? Autant de choses qui sont des accidents de la surface ; on peut les sentir en marchant, mais non pas en sentant. Ce qu’il y a d’universel dans l’ascenseur de Santa Justa, c’est la mécanique régissant le monde. Ce qu’il y a de vérité dans la cathédrale de Reims, ce n’est ni la cathédrale, ni la ville de Reims, mais la majesté religieuse des éfifices voués à la connaissance des profondeurs de l’âme humaine. Ce qui est éternel dans la culotte des zouaves, c’est la fiction colorée des costumes, langage humain qui crée une simplicité d’ordre social constitutant, à sa façon, une nudité nouvelle. Ce qui, dans les parlers régionaux, est universel, c’est l’intonation familière de gens qui vivent spontanément, la diversité des êtres proches, la succession bigarrée des façon d’être, les différences entre les peuples et la grande diversité des nations.
majesté des hauteurs dans le secret des profondeurs ; les saisons, les champs, les maisons, les gestes et les visages ; les costumes et les sourires ; l’amour et les guerres ; les dieux, finis et infinis ; la Nuit sans forme, mère de l’origine du monde ; le Destin, ce monstre intellectuel, qui est tout… En décrivant toutes ces choses, ou quoi que ce soit d’autre tout aussi universel, je parle à l’âme dans la langue primitive et divine, l’idiome adamique que tous les hommes comprennent. Mais quelle langue morcelée, quelle langue babélique parlerais-je si je décrivais l’ascenseur de la Santa Justa, la cathédrale de Reims, la culotte des zouaves ou la façon dont on prononce le portugais dans le Trás-os-Montes ? Autant de choses qui sont des accidents de la surface ; on peut les sentir en marchant, mais non pas en sentant. Ce qu’il y a d’universel dans l’ascenseur de Santa Justa, c’est la mécanique régissant le monde. Ce qu’il y a de vérité dans la cathédrale de Reims, ce n’est ni la cathédrale, ni la ville de Reims, mais la majesté religieuse des éfifices voués à la connaissance des profondeurs de l’âme humaine. Ce qui est éternel dans la culotte des zouaves, c’est la fiction colorée des costumes, langage humain qui crée une simplicité d’ordre social constitutant, à sa façon, une nudité nouvelle. Ce qui, dans les parlers régionaux, est universel, c’est l’intonation familière de gens qui vivent spontanément, la diversité des êtres proches, la succession bigarrée des façon d’être, les différences entre les peuples et la grande diversité des nations.

